César du meilleur film étranger en 1987, Le Nom de la Rose est ressorti en ce mois de février 2024 sur une poignée d'écrans dans une version restaurée, elle-même rééditée dans un coffret Blu-ray 4K, à paraître le 3 mai prochain. L'occasion de (re)découvrir dans des conditions idéales un film unique en son genre : un whodunit médiéval en pleine Inquisition, à l'ambiance poisseuse… et aux thématiques toujours tristement d'actualité.
Un écran noir. Un grondement suivi de quelques notes diaphanes. Comme venues d'ailleurs. D'aucuns pourraient y voir un avertissement. Pas de générique, mais une voix off. Celle d'un homme au crépuscule de sa vie. Ceci est son histoire. Plus qu'un témoignage, c'est un testament. Des événements troubles et dérangeants ont eu lieu en cette année 1327, au sein d'un monastère perdu dans le nord de l'Italie. Son nom ? Non, mieux vaut taire son nom. Alors que s'affiche celui du film.
Cette austérité, c'est celle de l'ouverture du Nom de la Rose, quatrième film du Français Jean-Jacques Annaud, sorti aux États-Unis le 24 septembre 1986 et deux mois plus tard en France. Une austérité révélatrice du ton global du film, qui n'a pourtant reculé devant rien pour adapter à l'écran aussi fidèlement que possible la vision d'Umberto Eco, auteur du roman éponyme publié six ans plus tôt. Une fiction historique teintée de policier devenue un instant classic en Italie puis en France, dont l'adaptation est mise très tôt en chantier, avec un budget colossal à l'époque pour ce type de projet : l'équivalent de près de vingt millions d'euros.
Une coproduction européenne, comme cela se faisait beaucoup à l'époque, entre la France, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, qui se paie le luxe de s'offrir l'un des réalisateurs tricolores les plus en vue du moment, Jean-Jacques Annaud, tout juste auréolé de l'immense succès critique et commercial de La Guerre du feu (meilleur film et meilleur réalisateur aux Césars 1982, plus de 7 millions d'entrées chez nous), et un ancien James Bond dans le rôle principal, Sean Connery. Le succès ne se fait pas attendre. Pas loin de 80 millions de dollars de recettes à travers le monde, 5 millions d'entrées dans nos contrées et un César du meilleur film étranger décerné l'année où Connery est également président de la cérémonie (coïncidence ?). Loin des standards bruyants et flashy des années 1980, Le Nom de la Rose a su toucher au-delà du public d'intellectuels auquel il aurait pu se cantonner. Au point, à son tour, de faire figure de nouveau classique, emblème d'un certain cinéma "à la papa". C'est à l'occasion de l'une de ses multiples rediffusions, probablement un jeudi soir sur France 3 en compagnie de mon père, que je me suis fait happer par la brume, le mystère et cette musique. Elle sonnait comme un avertissement. J'y ai vu une invitation.
Confesse-toi
Seigneur, pardonnez-moi car j'ai péché. Dans un précédent article, je clamais haut et fort mon indifférence à l'égard du whodunit, ce grand classique du genre policier où un enquêteur doit trouver l'identité du meurtrier au milieu d'un éventail réduit de suspects, le plus souvent regroupés au cœur d'un même lieu. J'ai menti. Par omission, certes, mais cela n'excuse rien. Car parmi les films qui ont posé les bases de ma cinéphilie, hantent mon imaginaire et réveillent en moi le doux souvenir d'une époque révolue, se trouve un représentant majeur du whodunit : Le Nom de la Rose.
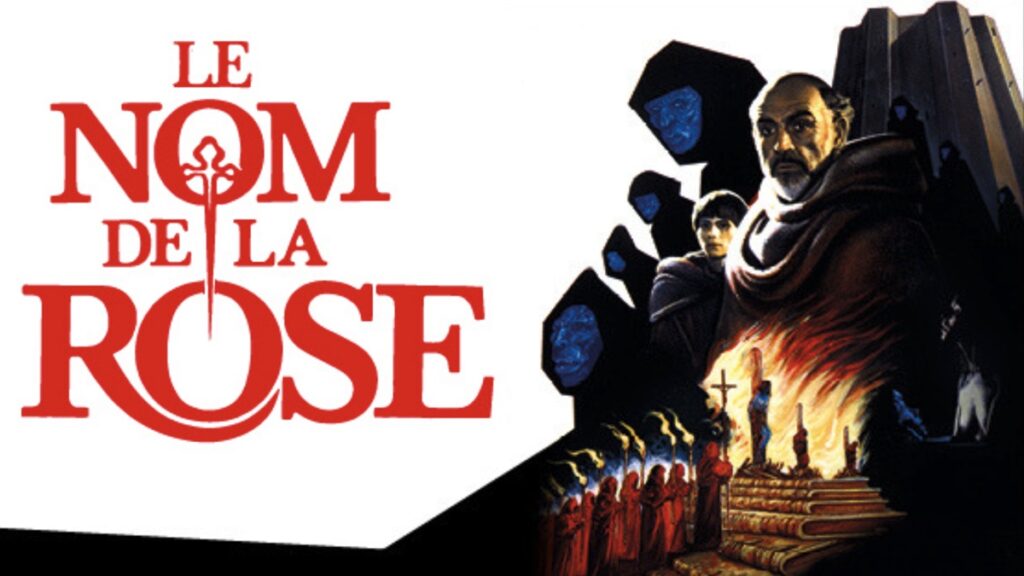
L'une des affiches les plus marquantes de son époque.
Le point de départ de l'intrigue respecte les codes du genre. Accompagné de son protégé Adso – campé par un tout jeune Christian Slater dont il s'agit du premier rôle majeur – le frère franciscain Guillaume de Baskerville arrive dans cette fameuse abbaye bénédictine du nord de l'Italie, dont le bâtiment principal, tel un inquiétant donjon, est juché sur une colline régulièrement cachée par le brouillard, surplombant un hameau de paysans crasseux au comportement grégaire. Très vite, le perspicace Guillaume découvre qu'un frère est mort peu avant leur arrivée, dans des circonstances qui se révèlent mystérieuses. Pas du genre à laisser le doute planer, notre duo se met à fureter, questionne les autres moines, découvre des lieux et des objets cachés et lève le voile sur nombre de secrets enfouis au cœur de l'abbaye. Ce, pendant que les morts inexplicables s'enchaînent et que le spectre d'une intervention de l'Inquisition se rapproche.

Le charisme fait homme.
Entre deux films catastrophes et trois visionnages des Dents de la mer, je découvre l'aura, le sourire en coin et le regard moqueur de Sean Connery, inoubliable Guillaume de Baskerville, bien des années avant d'être pour moi un James Bond sorti du passé. Il est ce héros narquois, aussi sage que sûr de lui, que j'estime alors au même niveau d'héroïsme qu'un Indiana Jones, loin des gros bras virilistes qui jouent du fusil mitrailleur ou de l'arc à flèches explosives dans des jungles tropicales. Son arme, c'est son cerveau, sa capacité de raisonnement. Son ironie parfois moqueuse aussi – oserais-je dire son… flegme ? – lui offrant un avantage considérable sur ses adversaires : celui de voir le monde sous un autre angle, aidé enfin par son empathie et le poids de ses regrets passés. Il est le mentor que l'on rêve tous d'avoir, franc, droit, sensible et compréhensif – dans la lignée, à la même époque, du Ramirez de Highlander, que je ne découvrirai que bien plus tard. Un bloc finalement plus complexe et friable qu'on ne le pense de prime abord, mais qui s'en sert pour faire triompher la justice et le bon sens face à l'obscurantisme et le fanatisme.

Bleus sont ses yeux, noire est son âme.
La noirceur, l'oppression, l'impunité des puissants, tout cela se retrouve personnifié en une copie en négatif de Guillaume, son alter ego tyrannique, bras armé d'une foi malade qui ne survit qu'en éradiquant toute différence et en accaparant les richesses : l'Inquisiteur Bernardo Gui. Un non résonnant en moi comme l'incarnation du mal absolu. Il est mon Dark Vador, commettant les pires exactions tout en étant convaincu d'œuvrer pour le bien. Mais sans la rédemption finale. Alors qu'il n'apparait que dans la dernière partie du récit, son empreinte sur le film est indélébile. Deux ans après avoir incarné Antonio Salieri, engeance noire et premier admirateur de Mozart dans le somptueux Amadeus de Miloš Forman – une autre pépite des années 1980 en décalage sur son temps – Murray Abraham est ici d'un froid glacial, monolithique. Pourtant, l'ennemi ultime, ce n'est pas lui. Il n'est que le symptôme, la partie visible. Ce contre quoi nous met en garde Le Nom de la Rose est bien plus dangereux qu'un homme seul.
Devil Inside
Dès le départ, et même s'il est accueilli comme le veut la tradition monacale, Guillaume de Baskerville dérange. Tel Snake Plissken dans New York 1997, sa réputation le précède. C'est un original : il réfléchit différemment, tient en haute estime des penseurs reniés par un pan de l'Église. Là où la majeure partie des frères sont prompts à voir dans cette série de meurtres l'œuvre du Diable, lui choisit de raisonner. Aux explications faciles et réductrices, perpétrés indifféremment par les deux ordres représentés dans le film (bénédictins et franciscains), lui privilégie le temps long, l'enquête. À l'émotion, l'instantanéité, le commentaire, il choisit la raison, encore et toujours, quitte à se démarquer un peu trop pour son propre bien. Même l'intervention des pouvoirs supérieurs et la menace d'un jugement pour pensées déviantes ne suffisent pas à le garder au silence. Il est la probité, le dernier rempart face à l'inhumanité.
Une déshumanisation à la source de tous les maux du film. C'est le rire, justement le propre de l'homme, que l'on cherche à bannir de cette abbaye, en punissant tous ceux qui osent s'y vautrer. Car le rire n'est rien d'autre que l'ennemi de la peur. Et s'ils n'ont plus peur, comment espérer les contrôler ? Le plaisir dans la futilité est ce qui permet à chacun de créer sa singularité. Le loisir est ce qui permet de s'enrichir en tant qu'être humain. La comédie, sous toutes ses formes, est ce qui permet de se saisir d'une certaine forme de réalité, tout en se jouant de ceux qui gardent leurs œillères, consciemment ou non. Le rire est inné, mais il peut être réfréné, nié, combattu, dans une logique d'intimidation et de privation de libre pensée.
Cette thématique universelle, voilà ce qui fait du Nom de la Rose bien plus qu'un simple whodunit. L'identité du meurtrier reste bien moins importante que ses raisons. D'autant que celle-ci peut se deviner facilement dès le milieu du film. Ici, l'aveugle n'est pas cet oracle qui transcende sa vision perdue en guidant les voyants vers une vérité qu'il est le seul à ressentir, ou qui fait fi de ce sens perdu pour exacerber les autres – pensez Daredevil, Donnie Yen dans John Wick 4 et Rogue One ou le personnage du fils dans Anatomie d'une chute – mais bien cet être perdu dans sa propre noirceur, qui veut propager l'obscurantisme en cachant la connaissance aux yeux du monde.
Books N' Roses
À ce titre, la symbolique du film n'est pas des plus subtiles. Si l'abbaye est constamment plongée dans un épais brouillard, ce n'est pas un hasard. Tout comme sa silhouette, filmée en contre-plongée, tantôt si imposante et inquiétante, qui ne prend plus, une fois l'intrigue démêlée, qu'une petite partie du cadre derrière un ciel devenu bleu. Mais s'il est en revanche un point sur lequel Annaud, comme Eco, se refusent à toute facilité, c'est celui du traitement du Moyen Âge.
Au premier regard, on peut ne ressentir qu'une énième variation sur cette époque trop souvent caricaturée comme le crépuscule de l'Humanité, coincée entre une Antiquité fantasmée, peuplée de scientifiques, de philosophes et de poètes, et la Renaissance, au nom bien trop équivoque, qui a vu naître en comparaison tant d'artistes et d'inventeurs de génie. On ne le répétera jamais assez : attention aux raccourcis faciles. Visuellement, les moines et leurs gueules impayables, censés être les gardiens du savoir, ne dépareilleraient pas au milieu des bouseux des Visiteurs, et les villageois d'en bas sont à peine plus évolués que les hommes préhistoriques de La Guerre du feu. Ce n'est qu'ensuite que l'on découvre que, parmi ces albinos, ces bossus et ces sauvageons, se cache une vraie sensibilité émotionnelle. Les mêmes émotions que l'Église veut étouffer et contrôler.
Le Nom de la Rose devient-il alors un brûlot anti-clérical ? Non plus. Au sein du clergé comme ailleurs, "il y en a des biens". Sans s'étendre sur les conflits théologiques qui secouent les différents ordres religieux de l'époque – ce dont le livre ne se prive pas – le film oppose deux camps, qui s'affrontent sur leur interprétation des textes concernant la pauvreté ou non du Christ. On vous laisse deviner lequel des deux est et restera au pouvoir. N'est pas le Grand Moineau qui veut. Guillaume de Baskerville lui-même est le reflet de tous ces savants et intellectuels de l'époque, dont la foi n'était qu'un instrument de plus. Face à ceux qui condamnent, lui s'extasie de la qualité du travail des enlumineurs, dans une esthétique d'ailleurs reprise récemment par deux jeux vidéo bien reçus par les joueurs et la critique, Pentiment et Inkulinati. En clair, et même si l'ensemble sent très fort la boue et le sang de cochon, ce n'est pas parce que l'on s'éclairait exclusivement à la bougie que tout y était sombre.
Rire pour le meilleur
Ce point de vue unique sur une période dominée au cinéma par de grandes épopées guerrières, où l'on s'intéresse davantage aux seigneurs et aux chevaliers qu'aux petites gens de peu, c'est incontestablement ce qui a frappé mon œil de pré-adolescent, aidé par une mise en scène nimbée de l'aura du mystère. Annaud maîtrise parfaitement son huis-clos, faisant parfois tendre son thriller vers l'horreur, à travers le regard d'un Adso qui a encore tout à découvrir du monde, de ses horreurs comme de ses plaisirs. Le fantastique se mélange même parfois au gothique, ici quand une foule incontrôlable prend les armes pour mener la révolte, ou là, quand Guillaume et Adso se perdent dans un dédale digne du labyrinthe d'Escher.
Whodunit, coming of age movie, thriller médiéval : Le Nom de la Rose est tout ça à la fois et en même temps beaucoup plus. C'est une mise en garde contre la disparition du savoir et de la pensée critique. Un rappel qu'ignorance et manipulation vont souvent de pair et que l'obscurantisme propagé par des réponses toutes faites est toujours plus imminent que l'Apocalypse. Que ceux qui veulent vous faire croire au grand effondrement de notre monde sont souvent ceux qui ont tout intérêt à faire perdurer le statu quo, en privant le peuple des moyens de sa propre résistance. Comme Guillaume de Baskerville, il faut alors (re)tomber amoureux de la connaissance et ne plus se laisser dicter sa pensée. Malgré la peur, sans oublier de rire. Parce qu'une société qui porte au rang d'hérésie le plaisir, l'accessoire et toute différence, on ne sait que trop bien son nom.







